Le nouveau pôle judiciaire spécialisé dans la répression des crimes de masse et des violences sexuelles : une mesure perfectible

Delva DIMANCHE, Enseignant-chercheur à l’UEH, Doctorant à l’Université Jean Moulin Lyon 3
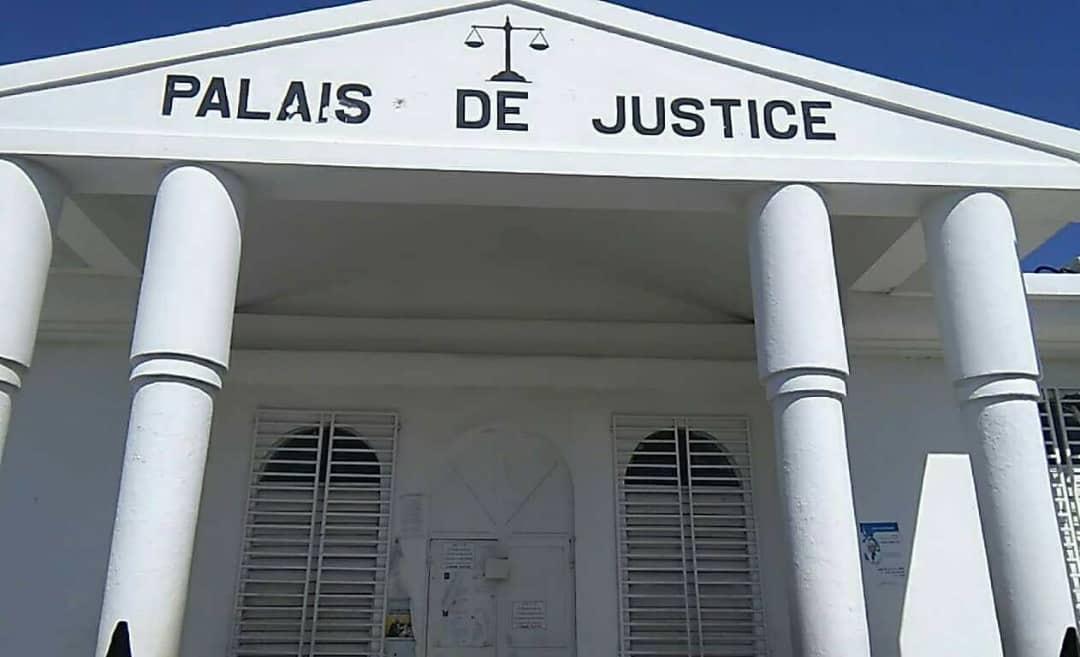
Le nouveau pôle judiciaire spécialisé dans la répression des crimes de masse et des violences sexuelles n’est plus un projet. En date du 16 avril 2025, le gouvernement haïtien a entériné celui-ci, aux côtés d’un autre pôle judiciaire spécialisé dans la répression des crimes et délits financiers complexes. La création du pôle qui nous intéresse dans le présent dossier intervient dans un contexte particulier. Il s’agit de trouver des mesures drastiques sur le plan judiciaire, face à la vague de violences qui se déferle dans la région métropolitaine de Port-au-Prince ainsi que dans d’autres villes de provinces, placées sous le contrôle des gangs armés. Cette mesure arrive à point nommé, puisque la situation de terreur qui règne dans ce pays est qualifiée de conflit armé interne par la Cour nationale du droit d’asile (française). Elle se distingue dès lors des simples situations de troubles internes, ce qui permet d’appréhender les actes perpétrés sous le chef d’accusation de crimes de guerre, tels que définis par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. La création « circonstancielle » de ce nouveau pôle judiciaire permet de poser un problème de fond, celui de la répression des crimes de masse, lesquels ne sont pas reconnus par la législation haïtienne. Le présent dossier se propose, d’abord, de souligner la portée de ce nouveau pôle judiciaire parmi les efforts de lutte contre le phénomène de l’impunité qui domine le pays (I). Ensuite, il sera apprécié sa singularité en tant que nouvelle structure juridictionnelle (II). Enfin, on évoquera ses lacunes par rapport à son ambition initiale et au contexte juridique dans lequel il s’introduit (III).
I. Portée
Le Code pénal haïtien en vigueur ignore catégoriquement les crimes de masse ou les crimes de droit international. L’affaire Duvalier, qui demeure sur ce point l’une des affaires les plus emblématiques, avait montré à cor et à cri les faiblesses du droit interne existant face à de tels crimes, qui s’illustrent par leur gravité. Lors de ce procès historique, les juridictions répressives haïtiennes étaient totalement divisées quant à la définition in concreto de la règle de droit applicable en l’espèce. D’un côté, l’ordonnance de la chambre d’instruction criminelle du Tribunal de première instance de Port-au-Prince avait écarté purement et simplement les poursuites judiciaires contre l’ex-dictateur ainsi que les autres personnes épinglées, considérant que les crimes pour lesquels ils étaient poursuivis ne sont pas reconnus par le Code pénal de 1835, et celui-ci ne contient aucune loi spéciale y relative. D’un autre côté, la Cour d’appel de Port-au-Prince avait maintenu les charges pour ce type de crimes en se basant sur le droit international coutumier, à la formation duquel Haïti a contribué.
Il est important de souligner que la décision de la Cour d’appel de Port-au-Prince redonnait espoir, d’une certaine façon, aux victimes de graves violations des droits de l’homme perpétrées durant le règne de Jean-Claude Duvalier. La Cour inscrivait son oeuvre dans « l’héritage de Nuremberg », pour lequel l’absence d’incrimination en droit interne ne peut être un facteur d’impunité. Cela rappelle le fameux obiter dictum découvert à travers ce procès pour l’histoire : « Ce sont des hommes, et non des entités abstraites, qui commettent les crimes dont la répression s’impose comme sanction en droit international ». Mais cette décision, fondée particulièrement sur le droit international coutumier, suscitait des critiques virulentes. Elle était dénoncée par les partisans du principe de légalité des crimes et des peines, qui y voyaient clairement une application douteuse du droit international.
Aujourd’hui, la création du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des crimes de masse et des violences sexuelles semble vouloir donner à ce principe la place qui lui revient dans l’ordre juridique haïtien. Désormais, il est créé une structure juridictionnelle spécialisée dans la répression de ces types de crimes. Cette mesure comporte, à notre sens, une double portée. La première, c’est qu’elle entend dissuader quiconque de passer à l’acte, puisque le droit interne n’est plus silencieux sur la question. Les auteurs potentiels de ces crimes devraient s’en abstenir, par crainte de la sanction pénale individuelle. La seconde résulte du fait que le passage à l’acte est sévèrement sanctionné par le juge interne lorsque la culpabilité est dûment établie. Par conséquent, l’office du juge judiciaire est consolidé en tant que garant des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Singularité
Plusieurs aspects distinguent le présent pôle vis-à-vis d’autres initiatives qui ont été explorées dans d’autres contextes nationaux. D’abord, on peut mettre en avant le fait qu’il s’agit une juridiction essentiellement nationale, en tout cas en ce qui concerne le produit final. Ce pôle n’est pas institué par un accord international, comme c’était le cas pour d’autres pays sortant de conflits meurtriers. Il n’est pas non plus une juridiction hybride, où siègent des juges nationaux et internationaux. Il regroupe en son sein uniquement de juges de l’ordre judiciaire haïtien.
Tel qu’énoncé dans son texte fondateur, il s’agit d’une structure juridictionnelle concentrée dans le centre, dans le sens qu’elle est rattachée uniquement au Tribunal de première de Port-au-Prince. Cependant, cela ne restreint pas sa compétence à cette juridiction, dans la mesure où elle exerce une compétence exclusive. C’est-à-dire, le pôle, bien que circonscrit dans la juridiction de la capitale, est automatiquement compétent pour les crimes de masse commis sur tout le territoire haïtien. Ainsi, lorsqu’un autre Parquet ou un autre magistrat est saisi à cette fin, il doit se dessaisir au profit de ceux qui sont spécialisés sinon affectés au pôle judiciaire en question.
Ce pôle judiciaire peut-être aussi relocalisé dans d’autres bureaux convenus pour les services de justice. La possibilité de pouvoir relocaliser le pôle permet, semble t-il, à la justice de s’adapter à la conjoncture, où les édifices publics sont la cible de toute sorte d’attaques. Des procès pour crimes de masse peuvent donc se tenir dans des endroits autres que celui indiqué dans le décret du 16 avril 2025 portant création dudit pôle.
III. Lacunes
Ce nouveau pôle judiciaire admet certaines lacunes, qui remettent en cause son ambition initiale. Avant tout, sa création est visiblement contraire à la volonté du constituant haïtien, lequel n’admet l’existence de tribunal spécial ou de juridiction contentieuse que lorsque ces mesures font l’objet d’une loi. Au surplus, il interdit toute juridiction extraordinaire sous quelque dénomination que ce soit. La situation actuelle justifie-t-elle cette atteinte à la charte fondamentale, quoique celle-ci ne soit plus adaptée aux réalités caractérisant les crimes de masse ?
Les crimes de masse en soi ne sont pas une expression juridique. Cette expression est utilisée pour décrire la dimension collective de tels crimes et le projet criminel qui en résulte. Leur commission implique une pluralité d’auteurs de même qu’une massification des victimes. Considéré sous cet angle, il faut regretter dans le décret du 16 avril 2025 l’absence de définition de cette notion. Cela constitue d’ailleurs un exercice préalable à tout travail de codification. La clarification des termes utilisés dans un texte de loi s’inscrit dans le souci de respecter au mieux le principe de légalité, qui est au coeur des grandes conventions internationales. Il faut noter aussi que les crimes de guerre ne sont pas mentionnés expressément dans le texte, aux côtés des crimes contre l’humanité et du crime de génocide. Ce constat doit être nuancé toutefois, en admettant que certains actes graves figurés dans le texte sont évidemment constitutifs de crimes de guerre. Mais aujourd’hui les exigences de clarté et de précision suggèrent au législateur d’aller jusqu’au bout de son imagination.
Par ailleurs, la volonté de rupture à l’impunité parait sélective, dans la mesure où les hauts responsables publics, qui sont le plus souvent associés aux violences de masse, pourront garder leur immunité ou leur privilège de juridiction. Autrement dit, la qualité officielle ne s’efface pas immédiatement, quoique la gravité des crimes en question. Le texte faisant l’objet du présent dossier a évité d’aborder ce sujet sensible en accordant la préséance au régime de droit commun. Il s’agit là d’un obstacle de taille aux poursuites judiciaires contre les personnalités officielles qui seraient impliquées dans la commission des crimes de masse, ce qui prête le flanc à l’impunité. De plus, l’imprescriptibilité de ces crimes n’est pas acquise. Le temps écoulé peut donc écarter leurs auteurs de l’arène judiciaire. Ces derniers pourraient reprendre place dans la société comme s’il ne s’était rien passé.
Enfin, les interférences relatives à une éventuelle entrée en vigueur du nouveau code pénal haïtien ne semblent pas suffisamment mesurées. À travers ce code pénal, le législateur utilise un langage juridique qui se diffère de celui qu’on observe dans le décret du 16 avril 2025. En effet, le premier texte se renferme dans le terme « crimes internationaux », tandis que le second préfère la notion de « crimes de masse ». Ce code pénal prévoit aussi des mesures dérogatoires aux régimes de droit commun telles que, la compétence universelle, le retrait de l’amnistie et de la prescription en ce qui a trait aux crimes contre l’humanité et au crime de génocide. Tel n’est pas le cas dans le présent décret, où ces notions ne sont pas abordées. S’agit-il de deux projets juridiques distincts ? La récente Commission chargée de la réforme pénale devra-t-elle harmoniser ces deux textes, dont l’un paraît plutôt conjoncturel tandis que l’autre se veut un projet pour l’avenir ?